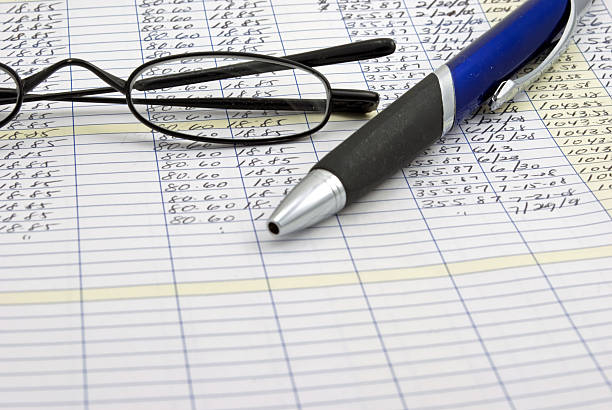Mise en demeure de payer : Mode d’emploi complet
Vous avez des factures impayées et souhaitez récupérer les sommes dues ? Quand un client ne règle pas ses factures malgré vos relances, il ne s’agit plus d’un simple oubli, mais d’un vrai problème . La mise en demeure de payer est en ce cas votre première arme juridique pour faire bouger les choses, avant de passer à l’étape judiciaire.
Mais concrètement, qu’est-ce qu’une mise en demeure de payer ? Comment bien la rédiger ? Comment la transmettre à son débiteur ? Et surtout, que faire ensuite ? On vous guide, pas à pas.

1. Qu’est-ce qu’une mise en demeure de payer ?
Lorsque les relances amiables restent sans effet, la mise en demeure devient l’étape formelle incontournable pour réclamer le règlement d’une dette. Il s’agit d’un courrier écrit, adressé par le créancier à son débiteur, dans lequel il exige le paiement d’une somme due dans un délai déterminé.
Ce document ne se contente pas de rappeler l’existence d’un impayé : il met en demeure le débiteur d’agir, sous peine de poursuites judiciaires. Il marque ainsi la frontière entre la phase amiable et la phase contentieuse du recouvrement.
🟪Comment envoyer une mise en demeure ?
La mise en demeure peut être transmise par différents canaux :
- par lettre simple (à éviter, car difficile à prouver en justice) ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception (le moyen le plus sûr) ;
- par courrier électronique, à condition de pouvoir prouver sa réception (signature électronique, preuve de lecture…) ;
- ou encore par remise par un commissaire de justice (ex-huissier), notamment sous forme d’une sommation de payer.
Peu importe la forme retenue, pour être juridiquement valable, cette mise en demeure doit être rédigée de manière claire et sans ambiguïté. Elle doit en effet constituer ce que le Code civil appelle une “interpellation suffisante” du débiteur (article 1344).
🟪Qui peut l’envoyer ?
La mise en demeure peut être rédigée et envoyée par :
- le créancier lui-même ou le service contentieux de son entreprise ;
- une société de recouvrement agissant en son nom (sous réserve du respect d’un certain formalisme légal) ;
- ou un commissaire de justice, qui pourra la délivrer avec une date certaine, conférant ainsi un poids supplémentaire au courrier (notamment si une action judiciaire s’ensuit).
⚠️ À noter : quelle que soit la personne ou l’organisme qui envoie la mise en demeure, elle ne vaut pas titre exécutoire et ne permet pas à elle seule de pratiquer une saisie. Elle est néanmoins un préalable souvent requis avant d’engager certaines procédures judiciaires.
🟪Les conditions de validité de la créance
Avant d’envoyer une mise en demeure, encore faut-il s’assurer que la créance remplisse trois critères essentiels. Le créancier doit pouvoir démontrer que la somme réclamée est :
- Certaine : l’existence de la dette ne doit faire aucun doute. Un bon de commande signé, une facture, un contrat, ou tout autre document probant est nécessaire.
- Liquide : son montant doit être précisément déterminé, et non estimé ou à évaluer ultérieurement.
- Exigible : le délai de paiement contractuel ou légal doit être échu, et la créance ne doit pas être atteinte par la prescription.
💡 Exemple : une facture arrivée à échéance depuis plus de 30 jours est, en principe, exigible. En revanche, une créance dont le montant n’est pas encore arrêté ou contestée sur le fond ne sera pas considérée comme liquide ou certaine.
🟪Et les frais de recouvrement ?
Une société de recouvrement ou un commissaire de justice ne peut pas facturer de frais supplémentaires au débiteur, sauf en présence d’un titre exécutoire (jugement, ordonnance, acte notarié, etc.). En effet, les frais liés au recouvrement amiable sont légalement à la charge du créancier, conformément à l’article 32, alinéa 3, de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
Attention, toute tentative de faire payer ces frais au débiteur, en l’absence de titre exécutoire, est passible de sanctions (contravention de 5e classe).
🟪Doit-on forcément relancer avant ?
Non. Aucune disposition légale n’impose d’effectuer plusieurs relances avant de passer à l’envoi d’une mise en demeure. Le créancier est libre de choisir son moment : il peut agir dès l’échéance impayée ou laisser passer un délai raisonnable en fonction de la relation commerciale ou de la nature du contrat.
👉 Ce choix peut être stratégique : dans certains cas, envoyer une mise en demeure trop vite peut nuire à la relation client. Dans d’autres, au contraire, cela permet de poser un cadre ferme et d’éviter les tergiversations.
La mise en demeure n’empêche pas non plus la négociation : il est toujours possible de proposer des échéanciers, remises ou délais supplémentaires, même après son envoi. Elle peut donc aussi servir de levier pour engager un dialogue plus structuré.
2. Comment envoyer une mise en demeure ?
Pour qu’une mise en demeure produise ses effets juridiques, elle doit pouvoir être prouvée, notamment en cas de contentieux. Le choix du mode d’envoi est donc important car il doit garantir la traçabilité et la date de réception.
Plusieurs options sont envisageables, mais toutes ne se valent pas juridiquement :
Les principaux modes d’envoi :
🔸Lettre simple : C’est le moyen le moins sécurisé. Bien qu’autorisé en théorie, il est fortement déconseillé, car il sera très difficile de démontrer que le destinataire a bien reçu le courrier. À éviter sauf pour un rappel informel.
🔸Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) : C’est le standard recommandé. Elle permet d’établir une date d’envoi, de réception (ou tentative de remise), et le contenu du courrier si vous en gardez une copie conforme.
🔸Lettre recommandée électronique (LRE) : Équivalente à la LRAR, elle peut être envoyée via des plateformes certifiées (comme La Poste ou des prestataires privés). Elle offre les mêmes garanties légales, à condition que le processus respecte les exigences du Code des postes et communications électroniques.
🔸Email avec preuve de réception : L’envoi d’une mise en demeure par email est juridiquement possible, mais il implique de pouvoir prouver la réception effective par le débiteur, ainsi que le contenu exact du message envoyé. Une simple mention “lu” ou un accusé de réception standard n’a pas de valeur probante suffisante devant un juge.
Pour sécuriser cet envoi, privilégiez le recommandé électronique (LRE) via un prestataire certifié, offrant des garanties légales comparables à une lettre recommandée papier (Par exemple : La Poste, AR24 …).
🔸Remise par commissaire de justice : Faire appel à un commissaire de justice (ancien huissier) permet de donner une date certaine à la mise en demeure, via une sommation de payer. Ce mode d’envoi est particulièrement adapté si vous envisagez une action en justice par la suite.
🔸Par voie de citation judiciaire : Dans certains cas, la mise en demeure peut être intégrée directement dans une procédure judiciaire (ex. : assignation en paiement, référé-provision…). Elle est alors signifiée par un commissaire de justice dans le cadre du contentieux.
⚖️ Bon à savoir :
Même si le destinataire ne retire pas le courrier recommandé, la mise en demeure n’est pas considérée comme nulle.
En effet, selon la Cour de cassation (1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-20.680), le simple fait qu’un courrier ait été présenté à la bonne adresse suffit à établir qu’il a été valablement notifié, même s’il est retourné avec la mention “non réclamé”.
🔎 Conséquence : le débiteur ne peut pas se soustraire à ses obligations simplement en refusant de réceptionner un recommandé !
3. Quelles mentions une mise en demeure doit-elle obligatoirement contenir ?
Pour qu’une mise en demeure soit reconnue comme telle et produise ses effets en droit (comme faire courir les intérêts de retard ou permettre une action judiciaire), elle doit comporter un minimum de mentions précises et non équivoques.
✔️Mentions générales à intégrer dans toute mise en demeure :
Une mise en demeure bien rédigée doit inclure les éléments suivants :
- La mention explicite de “mise en demeure”, soit en en-tête, soit dans le corps du courrier ;
- La date d’envoi ;
- Les coordonnées complètes du créancier et du débiteur (nom, adresse, éventuellement téléphone ou email) ;
- La nature de la créance : facture impayée, prestation non réglée, loyer, etc. ;
- Le montant exact réclamé, avec le cas échéant la référence de la facture ou du contrat concerné ;
- Le délai accordé pour régulariser la situation (généralement entre 7 et 15 jours) ;
- Les conséquences en cas de non-paiement : par exemple, le recours à une procédure judiciaire ou l’application d’intérêts de retard.
💡 Même si certaines informations juridiques comme le numéro SIRET, la forme sociale ou le capital de l’entreprise ne sont pas exigées, leur présence peut renforcer le caractère professionnel du courrier.
✔️Si la mise en demeure est rédigée par le créancier lui-même ou par un commissaire de justice :
Dans ce cas, on attend du courrier qu’il comporte :
- L’identité complète du débiteur (raison sociale, adresse) ;
- Un exposé clair et concis des faits (nature du contrat, objet de la réclamation, etc.) ;
- Une formulation non équivoque de la demande de paiement (ex. : “nous vous mettons en demeure de régler…”)
- Le montant dû et son fondement (facture n°XXX, échéance dépassée le JJ/MM/AAAA) ;
- Le délai laissé pour le paiement (ex. : 8 jours à compter de la réception du courrier) ;
- Les coordonnées du créancier ou de son représentant, accompagnées de la signature ;
- Une menace raisonnable et réaliste de recours en justice si aucune réponse n’est donnée.
📝 Important : La clarté du ton et la précision des termes sont déterminantes. Une simple demande “amicale” ne suffit pas. Il faut qu’il s’agisse d’une sommation ferme, dans les formes.
✔️Si la mise en demeure est envoyée par une société de recouvrement :
Lorsqu’un cabinet de recouvrement intervient pour le compte du créancier, le formalisme à respecter est strict, sous peine de sanctions :
La lettre doit comporter obligatoirement :
- Le nom ou la raison sociale, l’adresse du cabinet, et la mention claire de son activité de recouvrement amiable de créances ;
- Les coordonnées du créancier pour le compte duquel l’action est menée ;
- Le montant total de la créance, décomposé de manière précise :
– principal,
– intérêts éventuels,
– frais accessoires autorisés (mais hors frais de recouvrement, sauf en cas de titre exécutoire) ;
- Une invitation explicite à payer, précisant les modalités (virement, chèque, etc.) ;
- Et surtout : la reproduction obligatoire des alinéas 3 et 4 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, qui rappellent que les frais de recouvrement amiable sont à la charge du créancier, sauf décision judiciaire contraire.
⚠️ L’absence de l’une de ces mentions peut être considérée comme une infraction, punie d’une contravention de 5e classe, soit jusqu’à 1 500 € d’amende par infraction constatée.
4. Quels sont les effets juridiques d’une mise en demeure ?
À la différence d’une simple relance, la mise en demeure n’est pas un simple rappel poli : elle a une portée juridique bien définie. Elle formalise le manquement du débiteur à ses obligations et marque le début d’une nouvelle phase dans la relation contractuelle.
Voici les principales conséquences juridiques qu’elle entraîne :
- Déclenchement des intérêts de retard : À compter de la date indiquée dans la mise en demeure, le créancier peut légalement réclamer des intérêts moratoires calculés selon le taux applicable (souvent prévu au contrat ou fixé par le Code de commerce).
- Activation de clauses contractuelles spécifiques : Certaines conventions prévoient qu’en cas de mise en demeure restée sans effet, le créancier peut demander la déchéance du terme. Cela signifie que l’ensemble des sommes dues (et non seulement l’échéance impayée) deviennent immédiatement exigibles.
- Ouverture d’un droit à indemnisation : Si le retard ou l’inexécution a causé un préjudice (perte financière, retard de projet, etc.), la mise en demeure peut constituer un préalable nécessaire à une demande de dommages et intérêts.
- Suspension des obligations du créancier : Dans les contrats synallagmatiques (où les obligations sont réciproques), la mise en demeure peut permettre au créancier de suspendre sa propre exécution tant que l’autre partie ne s’est pas acquittée de ce qu’elle doit.
📦 Exemple : un fournisseur peut refuser de livrer une commande tant que la facture précédente n’a pas été réglée.
💡 En résumé, la mise en demeure ne se limite pas à “mettre la pression” au débiteur. Elle est un outil juridique puissant, à manier avec précision, pour faire valoir ses droits de manière formelle et préparer sereinement une éventuelle action en justice.
5. Que faire si la mise en demeure reste sans réponse ?
Lorsque la mise en demeure est ignorée ou que le débiteur refuse de régulariser sa situation, le créancier dispose d’une option claire : saisir la justice pour obtenir le recouvrement forcé de sa créance. On entre alors dans la phase de recouvrement judiciaire.
Plusieurs voies de recours sont possibles, à adapter selon la nature de la dette, son montant et l’urgence de la situation :
-
L’injonction de payer
C’est la procédure la plus simple et la plus économique. Elle consiste à adresser une requête écrite au greffe du tribunal (généralement le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, selon le type de créance), sans audience.
👉 Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur dispose alors d’un délai d’un mois pour faire opposition. En l’absence de contestation, l’ordonnance devient exécutoire.
-
Le référé-provision
Il s’agit d’une procédure rapide et contradictoire, utilisée lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.
Le créancier saisit le juge des référés pour obtenir le versement immédiat d’une somme à valoir sur la dette. Une audience est organisée en présence des deux parties. Cette procédure est souvent choisie lorsque l’urgence ou la nécessité d’une trésorerie immédiate se fait sentir.
-
L’assignation au fond
C’est la procédure judiciaire classique, plus longue et généralement plus coûteuse. Elle consiste à assigner le débiteur devant le juge pour qu’il rende une décision au fond, après examen complet du litige.
Ce recours est adapté lorsque :
- la créance est contestée de manière sérieuse ;
- ou lorsqu’un titre exécutoire complet est nécessaire pour engager une saisie sur les biens du débiteur.
Envoyer une mise en demeure, c’est montrer que la situation devient sérieuse. C’est souvent ce déclic qui pousse enfin un client à réagir. Et si rien ne bouge ? Il faut vous tenir prêt à passer à l’étape suivante : faire valoir vos droits devant la justice …